Votre panier est actuellement vide !

Charité chrétienne et transformation sociale : des premiers martyrs aux œuvres caritatives

L’œuvre de Léon Lallemand, “Histoire de la Charité“, offre une analyse riche et détaillée des débuts du christianisme et de l’évolution de la charité en tant que principe moral et pratique. Il retrace comment la charité chrétienne s’est distinguée de la bienfaisance païenne pour devenir une force sociale et spirituelle influente, s’enracinant profondément dans la doctrine chrétienne.
Contexte historique et moral de l’Empire romain
L’ouvrage commence par une description de la situation morale et religieuse dans l’Empire romain après la bataille d’Actium (31 av. J.-C.) et sous le règne d’Auguste. L’auteur décrit un empire vaste mais marqué par une corruption morale et un mépris profond de la vie humaine. Les orgies, les jeux scéniques, et une perversion généralisée caractérisent la vie des Romains de l’époque, tandis que la religion païenne, loin de guider vers une morale élevée, encourage les pires excès. Lallemand cite Tacite et Salluste pour illustrer la décadence des mœurs romaines, précisant que la violence et la luxure étaient omniprésentes dans la société.
Dans ce contexte, l’auteur présente l’arrivée du christianisme comme une rupture radicale avec les valeurs païennes. Jésus-Christ, selon Lallemand, incarne l’humilité, le respect des faibles, et l’amour universel. Contrairement aux pharisiens juifs ou aux philosophes grecs, Jésus prêche la charité envers les pauvres, les malades et les marginaux, remettant en cause les hiérarchies sociales et les normes morales de l’époque. Ce nouveau message se distingue par son insistance sur l’amour du prochain et le sacrifice personnel au nom de la charité.
La charité comme fondement de la société chrétienne
Dès les premiers jours du christianisme, la charité devient un principe central dans l’organisation des communautés chrétiennes. Après la Pentecôte, l’Église de Jérusalem met en place un système de partage des biens pour assurer que personne ne manque de quoi que ce soit. Lallemand évoque les Actes des Apôtres pour montrer comment les nouveaux convertis partageaient leurs terres et leurs richesses, mettant tout en commun pour le bien de tous.
Il cite également des tensions internes, notamment entre les hellénistes (des Juifs convertis parlant grec) et les juifs araméens. Malgré ces divisions, la charité demeure le ciment de la communauté chrétienne, et c’est dans ce contexte que sont institués les premiers diacres, chargés de veiller à la juste répartition des ressources. Loin d’être une forme de communisme imposée, Lallemand précise que cette charité est volontaire, chaque membre de la communauté étant libre de contribuer selon ses moyens.
Les premières œuvres de charité
L’Église primitive développe une organisation de charité qui évoluera au fil des siècles. Lallemand décrit comment les diacres et diaconesses se chargent de la distribution des aumônes, des soins aux malades, et de l’aide aux orphelins et veuves. Cette structure, bien qu’encore rudimentaire, se développe rapidement pour inclure des œuvres permanentes, financées par les dons des fidèles. Le soin aux pauvres est considéré comme un devoir sacré, enraciné dans les enseignements du Christ.
Par exemple, saint Laurent, diacre de l’Église de Rome, aurait montré au préfet romain les pauvres de la ville, les désignant comme les véritables trésors de l’Église. Ce récit illustre la manière dont le christianisme renverse les valeurs sociales romaines, en élevant les plus humbles au rang des favoris de Dieu.
L’impact de la persécution sur la charité chrétienne
Lallemand souligne également comment les persécutions subies par les chrétiens sous l’Empire romain ont façonné leur vision de la charité. Plutôt que de fuir ou de se rebeller, les chrétiens choisissent de répondre à la haine par l’amour, en prenant soin non seulement de leurs frères en Christ, mais aussi des païens qui les persécutaient. Les catacombes et les cimetières chrétiens deviennent des lieux non seulement de sépulture, mais aussi de solidarité et d’aide aux nécessiteux.
Le cas des esclaves est particulièrement important. Les Apôtres, tout en prêchant l’égalité de tous devant Dieu, n’encouragent pas la révolte des esclaves. Lallemand explique que l’Église adopte une approche prudente : elle encourage les maîtres à traiter leurs esclaves avec justice et pousse les affranchissements volontaires. Les esclaves sont accueillis dans l’Église comme des frères à part entière, et certains, après avoir été affranchis, deviennent même des évêques, comme l’illustre l’exemple de saint Calliopius.
La disparition progressive de l’esclavage
L’un des points clés de l’analyse de Lallemand est l’influence du christianisme sur la disparition progressive de l’esclavage dans l’Empire romain. Au lieu de prôner une abolition immédiate et violente, l’Église favorise une transformation graduelle des relations sociales. En instillant l’idée que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu et que la charité est un devoir moral, l’Église prépare lentement la voie à une société où l’esclavage devient de plus en plus intolérable.
Parmi les exemples cités, l’auteur raconte l’histoire d’Hermès, un chrétien qui affranchit 1250 esclaves le jour de Pâques, illustrant la manière dont la foi chrétienne pousse certains propriétaires à renoncer volontairement à leurs droits sur leurs serviteurs. Le même esprit anime Chromatius, un magistrat romain qui, après sa conversion, libère tous ses esclaves et leur donne de quoi subvenir à leurs besoins.
La charité institutionnalisée et la création des diaconies
Enfin, Lallemand montre comment la charité devient progressivement institutionnalisée dans l’Église, avec la création de diaconies chargées de la gestion des œuvres caritatives. Ces structures permettent de centraliser les ressources et d’organiser de manière plus efficace la distribution des secours. Les quêtes régulières, les dons volontaires et les legs testamentaires permettent de financer ces œuvres, qui s’étendent aux malades, aux prisonniers, et aux voyageurs.
Les évêques, en particulier, jouent un rôle central dans cette organisation. Ils sont responsables de la bonne gestion des biens de l’Église et de leur distribution équitable. Leurs décisions en matière de charité ne sont soumises qu’à l’autorité de Dieu, ce qui leur confère un pouvoir considérable mais aussi une responsabilité morale immense.
En conclusion, Lallemand présente la charité chrétienne comme une véritable révolution morale, qui s’oppose frontalement aux valeurs de l’Empire romain. En prônant l’amour du prochain, le respect des faibles, et la justice sociale, le christianisme contribue à transformer en profondeur les relations sociales. Cette transformation, bien que lente et souvent entravée par les persécutions, finit par aboutir à la disparition de l’esclavage et à l’émergence d’une société plus équitable.
L’auteur montre également comment cette charité, d’abord spontanée et individuelle, devient progressivement une institution structurée, jouant un rôle central dans l’Église et dans la société. À travers des exemples concrets et des citations des Écritures, Lallemand illustre l’importance de la charité chrétienne dans les premiers siècles de l’Église et son impact durable sur le monde occidental.
Histoire de la charité – les 9 premiers siècles de l’ère chrétienne – Tome 1
La femme est émancipée, non pour le désordre, à la manière des matrones romaines de la décadence, car la loi de l’Évangile qui brise le despotisme domestique relie les membres d’une même famille par des obligations mutuelles. La sainteté du mariage entraîne son indissolubilité…
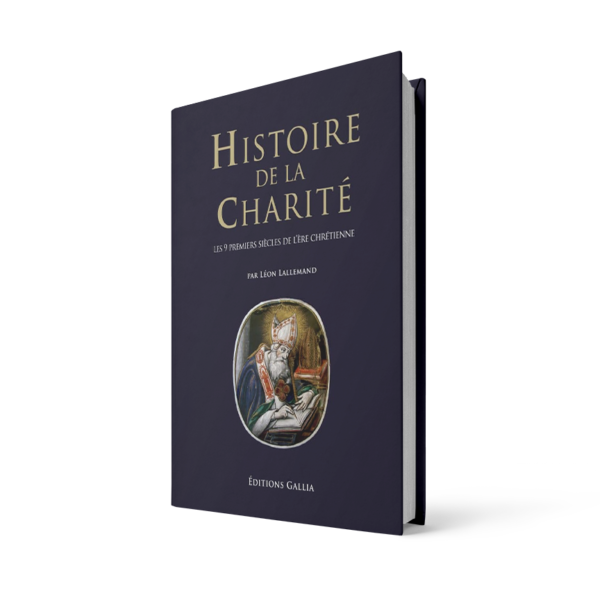
Laisser un commentaire