Votre panier est actuellement vide !

La Fronde sous Louis XIV : quelles en sont les raisons ?
Le 13 avril 1655, le roi de France, Louis XIV, prend la direction de Paris pour mater les parlementaires qui, après avoir voté un édit royal, en conteste la pertinence. Comme il en a la possibilité, le roi entre dans le Parlement et affronte les parlementaires contestataires. Le jeune souverain rappelle que les parlementaires lui doivent obéissance et fidélité. Le président du Parlement lui rétorque que lui et ses membres n’agissent que pour le bien de l’État. Louis XIV répondra par cette phrase devenue célèbre, même si certains historiens en contestent l’authenticité, – “l’État c’est moi !”. Qu’elle soit apocryphe ou non, cette phrase révèle plutôt bien la volonté du roi Louis XIV de s’assurer le contrôle de l’État et de concentrer les pouvoirs entre ses mains. Cette volonté d’atteindre le pouvoir absolu, s’explique par un événement majeur que Louis XIV a vécu pendant son enfance. La Fronde.
Les origines de la Fronde.
Quels sont les principaux évènements de la Fronde ?
En 1643, Louis XIII, le roi de France, trépasse après trente-trois ans de règne. Son fils, le futur Louis XIV, n’a que cinq ans seulement. Ne pouvant régner à ce jeune âge, une régence se met alors en place. La reine Anne d’Autriche, et le premier ministre Jules Mazarin, prennent les rênes du royaume. L’ambiance au sein du royaume est pour le moins électrique. Beaucoup de nobles et de parlementaires souhaitent s’affranchir de l’autorité de la régente. Il faut se souvenir que depuis la régence de Catherine de Médicis, entre 1547 et 1563, mettre une femme au pouvoir est perçu comme un signe d’instabilité pour le royaume et pour aggraver la situation, le cardinal Mazarin est Italien. Les tensions sont alors au summum. Le 18 mai 1643, lorsque Anne d’Autriche fait tenir par son fils un lit de justice, dans lequel le roi déclare que sa mère assurera seule la régence. Quant à Mazarin, il aura un rôle de ministre uniquement. Par cette décision, Louis XIV révoque les vœux de Louis XIII, son prédécesseur.
Au début de l’année 1648, le surintendant Piscicelli augmente les impôts et oblige les Parlements à l’accepter malgré leur désaccord. Il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère des Parisiens. La révolte gronde. Le 15 janvier 1648, Mazarin décide d’organiser un lit de justice en compagnie du roi pour faire adopter plusieurs édits fiscaux dans le but de financer la guerre contre l’Espagne qui dure depuis 1635. Louis XIV, encore enfant, en oublie ce qu’il doit prononcer et le lit de justice est refusé par les parlementaires. Débute alors une lutte acharnée entre Mazarin et le Parlement. Cet affrontement se terminera le 9 juillet avec la signature d’une charte qui aura pour fonction de préserver les droits des Parlements et d’annuler les édits fiscaux. La monarchie a cédé face aux parlementaires. La régence n’apprécie pas le contrôle progressif opéré par les parlementaires sur le souverain. Le 31 juillet, un nouveau lit de justice est organisé pour appliquer les articles en lois. Mazarin n’a pas l’intention de le respecter. Le Parlement souhaite voter librement les lois. La régence n’a plus de temps à perdre, pour conserver son autorité, elle doit agir rapidement.
Qu’étaient les Parlements ? Les Parlements d’Ancien Régime sont des administrations territoriales faisant office de tribunaux. Ils enregistrent les lois, mais peuvent également s’opposer au roi par en utilisant leur droit de remontrance. Le roi peut les révoquer en tenant un lit de justice. Le royaume de France compte à cette époque dix Parlements répartis dans les principales villes du royaume et pas moins de deux cents personnes y travaillent.
La fronde parlementaire (1648-1649)
Le 26 août 1648, une cérémonie religieuse est organisée pour fêter la victoire de Lens contre l’Espagne. Le roi et sa cour assistent à la messe tout comme les parlementaires. Une fois la cérémonie terminée, les trois principaux activistes de la Fronde – René de Potier de Blancmesnil, Louis Charton et Pierre Broussel, sont arrêtés. C’en est trop ! Les bourgeois parisiens et la population se révoltent et bloquent la ville, en enfermant Mazarin et Anne d’Autriche. Du 26 au 28 août, des barricades sont installées et les activistes sont libérés. Les milliers d’hommes de la garde parisienne essaient de les traverser pendant que les régents réussissent à s’enfuir de Paris. Les régents se réfugient au château de Rueil. Le 22 septembre, le parlement demande le retour de Louis XIV dans la capitale et la libération du ministre Léon Bouthillier, comte de Chavigny, fervent opposant de Mazarin. Anne d’Autriche refuse.
Le 22 octobre, après avoir subi de lourdes pressions, Mazarin cède aux parlementaires. Le ministre est attendu pour signer, deux jours plus tard, le 24 octobre 1648, la paix de Westphalie et ainsi mettre un terme à la Guerre de trente ans. La monarchie est sous contrôle des parlementaires.
Le siège de Paris
Le 31 octobre 1648, la régence relâche un peu la pression en libérant le comte Chavigny. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la régence, accompagnée de toute la cour, se cloître à Saint-Germain-en-Laye. Le ministre Mazarin prépare la reconquête de Paris. Pour y parvenir, il missionne ne duc de Condé d’assiéger Paris. Muni de moins de dix mille hommes, le duc ne peut bloquer que les grands axes parisiens. La capitale demeure malgré tout dans la possibilité de se ravitailler. Le siège de Paris va durer trois mois. Le 4 mars 1649, des négociations sont entreprises et aboutissent au traité de Saint-Germain le 1er avril 1649. Le traité annule tous les décrets votés par le Parlement depuis le 16 janvier dont celui qui stipule que l’éducation du roi doit être confiée au Parlement. La paix de Saint-Germain met fin à la première Fronde.
La Fronde des princes (1650-1653)
Malgré la paix survenue depuis peu, Mazarin demeure toujours aussi impopulaire. La monarchie reste toujours contrôlée par le Parlement. Après le siège de Paris, apparaissent, dans tout le royaume, des “Mazarinades”, à savoir des journaux satiriques se moquant ouvertement de Mazarin. Le but est ni plus ni moins que de créer de la tension entre Condé et Mazarin. D’anciens frondeurs voudront en profiter pour relancer les hostilités et rallier le duc de Condé à leur cause. Le 11 décembre, un attentat raté est perpétré contre Condé. Le coupable n’a pu être identifié, le Parlement de Paris est convoqué dès le 13 décembre 1649. Les témoignages récoltés accusent le cardinal de Retz, qui fut aux côtés des frondeurs. Il ne s’agissait que de faux témoignages. Condé, humilié, s’en prend au cardinal Mazarin et à la reine. Face à cet affront, la reine pense à arrêter Condé. Les anciens frondeurs se rallient à la reine et le 18 janvier 1650, Condé, son frère et son beau-frère, sont arrêtés. Mazarin est certain d’avoir renforcé son autorité, il ne le sait pas encore, mais il vient de relancer la Fronde. Les partisans de Condé se révoltent et débute alors la fronde des princes.
Des révoltes éclatent dans tout le royaume et la monarchie organise des campagnes militaires un peu partout sur le territoire. La première se déroule en Normandie, elle tourne rapidement à l’avantage du roi et de ses partisans. En avril 1650, commence la campagne de Bourgogne. Louis XIV, qui effectue ses premiers combats, prend ses quartiers à Dijon. En juillet 1650, la campagne de Guyenne débute, le pouvoir royal rase le château de la Rochefoucauld et assiège Bordeaux le 5 octobre de la même année. En raison d’un accueil pour le moins froid par les habitants, la campagne est une victoire en demi-teinte. Les opposants à la monarchie reste importante dans cette partie du royaume. Le cardinal de Retz, meneur de la première heure, craignant une réconciliation entre Condé et Mazarin, se mobilise pour encourager les anciens frondeurs à rejoindre le parti des princes. Condé et ses partisans contrôlent désormais Paris.
Au même moment, Louis XIV remporte une victoire contre les amis de Condé alliés aux Espagnols à Rethel le 13 décembre 1650.
Malgré ces succès, la régence n’arrive pas à affirmer son autorité. Les frondeurs sont beaucoup trop nombreux et unis autour d’une même cause : écarter Mazarin du pouvoir. L’union des frondes effraie le cardinal qui craint de subir le même sort que Charles Ier d’Angleterre qui fut décapité en 1649 par des révolutionnaires. Le Parlement intensifie ses exigences. Le 8 février 1651, la reine Anne d’Autriche doit consentir à exiler Mazarin, il a quinze jours pour quitter le territoire. Elle doit également jurer qu’aucun ministre étranger devienne ministre d’État. Craignant pour son titre, Anne et son fils, essaient de quitter la capitale, mais les portes de la ville leur sont fermées. La reine et le roi sont alors prisonnier au cœur même de Paris.
Le 13 février, Mazarin libère le duc de Condé, Gonti et Longueville qui entrent triomphalement dans Paris. En avril de la même année, suite à de nombreux désaccords sur la nécessité de poursuivre la Fronde, l’union des deux frondes (parlementaire et princière) est rompue. Seuls les princes et les partisans de Condé poursuivent le combat.
Qu’est-ce que la Fronde sous Louis XIV ? Il s’agit d’une rébellion des parlementaires et des princes du royaume envers l’autorité croissante de la monarchie. Elle eut lieu pendant la minorité du roi Louis XIV, entre 1648 et 1652
La guerre condéenne
Le 5 septembre, la reine, conseillée par Mazarin, accorde l’amnistie totale au duc de Condé. Le même jour, le roi Louis XIV fête ses treize ans. Par l’ordonnance de Charles V, le voilà désormais majeur. La régence s’achève. Il remplace immédiatement Mazarin, ministre d’État, par Charles de l’Aubespine, marquis de Châteauneuf et sélectionne des ministres hostiles à Condé. La Fronde n’est pas encore terminée. Après une défaite dans la Meuse, Condé se réfugie en Guyenne, là-bas, il compte bien mobiliser le Poitou contre le roi de France. Le 30 septembre, Louis XIV s’en va avec quatre mille hommes vers la Guyenne alors que les partisans de Condé se réfugient à Bordeaux. Débute alors le siège de Montrond entre le mois d’octobre 1651 et le mois de septembre 1652. A partir du mois d’octobre, la reine-mère, demande à Mazarin de revenir en tant que ministre d’État. De son côté, Condé réussit à mobiliser trois mille hommes dans le Poitou mais le duc de Bouillon et de Turenne l’abandonne, empêchant Condé de soulever d’autres provinces. Alors en infériorité numérique, Condé se réfugie à la Rochelle mais c’est sans compter sur la détermination de Louis XIV qui le prend en chasse. Condé parvient à éviter l’encerclement en se réfugiant à Bourg sur Gironde. L’armée royale continue de se renforcer. Le 12 décembre, le roi de France ordonne à Mazarin de le rejoindre. Le ministre arrive à Poitiers le 18 janvier 1652 avec sept mille hommes. Entre février et avril 1652, la campagne de la Loire débute avec la prise d’Angers, de Tours et de Blois par Louis XIV. L’armée royale prend immédiatement en chasse le duc de Condé qui était en train de prendre la fuite. L’objectif de Condé est claire : regagner la capitale, le siège du pouvoir. Le 11 avril 1652, Condé entre dans Paris mais le Parlement refuse de l’accueillir, le risque que Paris devienne un champs de bataille est trop grand.
Le 1er juillet 1652 débute la bataille du faubourg Saint-Antoine. Les armées de Condé et les troupes royales s’affrontent autour de la ville avec pour objectif de s’en emparer en premier. Le lendemain, 2 juillet 1652, l’armée de Condé est sur le point de perdre, comme par miracle, les portes de Paris s’ouvrent et ainsi le voilà dans la mesure de se réfugier. Condé gagne la bataille mais à quel prix… deux milles morts sont à déplorer.
Quelles sont les raisons de la Fronde ? La Fronde naît d’un mécontentement dans la population française. Le soulèvement prit sa source dans une crise économique latente et dans l’aggravation de la fiscalité en raison, notamment, de la guerre de trente Ans.
Le retour de Louis XIV à Paris
Une fois arrivé à Paris, Condé impose sa loi. Les parlementaires, notables et nobles, accusés de soutenir Mazarin, sont attaqués. Le 4 juillet 1652, Condé regroupe trois cent notables issus du clergé, de la noblesse et du Tiers état. Il annonce vouloir faire la paix une fois que Mazarin aura quitté le pouvoir. Les princes considèrent cette proposition trop timorée et déclare devant la foule que cette assemblée soutient Mazarin. Un soulèvement populaire s’engage avec des pillages et des incendies. Des milliers de morts sont à déclarer. La Fronde perd pied à partir de ce moment. Pour accentuer leurs divisions, Mazarin, en fin stratège, décide de s’exiler à ce moment. Des manifestations royalistes vont commencer au cœur même de la capitale avec pour revendication le retour du roi. Louis XIV, alors installé à Compiègne, attend patiemment une capitulation sans conditions. Perdant un à un ses soutiens comme le duc Charles IV de Lorraine, Condé quitte Paris en direction des Flandres.
Le 21 octobre 1652, Louis XIV, alors exilé depuis un certain temps, entre dans Paris avec les honneurs. Le 3 février 1653, Mazarin rentre de son exil, la Fronde en a plus pour longtemps. Arrivé à l’hiver, une nouvelle et dernière campagne va alors commencer, les quelques villes encore soutiens de Condé vont tomber une à une. La ville de Bordeaux tombe en juillet 1653. Alors que Condé préparait une offensive, le 13 août, Villeneuve-sur-Lot, sous influence de Condé, tombe aux mains de la monarchie. Ainsi prend fin la Fronde. Condé est déchu et condamné à mort par Louis XIV.
Pendant dix ans, Condé travaillera pour le compte de l’Espagne, avant d’être définitivement amnistié en 1659.
Les conséquences de la Fronde
La Fronde a mis un frein temporaire à la politique de centralisation du pouvoir autour du roi. Les parlementaires voulaient conserver leurs avantages et leur pouvoir sur les provinces du royaume. Cette opposition au pouvoir royal, plutôt que de la freiner, a accéléré sa centralisation. Les événements de la Fronde ont marqué pour toujours le jeune Louis XIV, si bien qu’au cours de son règne, il fera tout que de tels événements n’aient plus lieu. Le centre du pouvoir se situera désormais à Versailles pour éviter d’être à nouveau prisonnier des Parisiens. Une fois Mazarin trépassé, en 1661, le roi de France proclame que le prochain ministre d’État sera…Louis XIV lui-même. Les affaires du royaume sont maintenant sous le contrôle du roi seulement et les nobles éliront domicile à ses côtés, à Versailles, pour mieux les surveiller. En 1673, le roi autorise le parlement à contester les édits royaux mais seulement après les avoir adoptés.
Quels sont les principaux acteurs de la Fronde des princes ?
– Monseigneur de Gondi, futur cardinal de Retz
– Le prince de Conti
– Mademoiselle de Montpensier, appelée aussi « la Grande Mademoiselle »
– Le duc et la duchesse de Longueville.
Ce qu’était un roi de France
La propagande révolutionnaire et plus de deux siècles construits sur ce socle bien tassé font que, depuis longtemps, plus personne en France ne sait exactement ce qu’était un roi de France, pas plus que comment ces rois étaient considérés par leurs sujets, nos ancêtres.
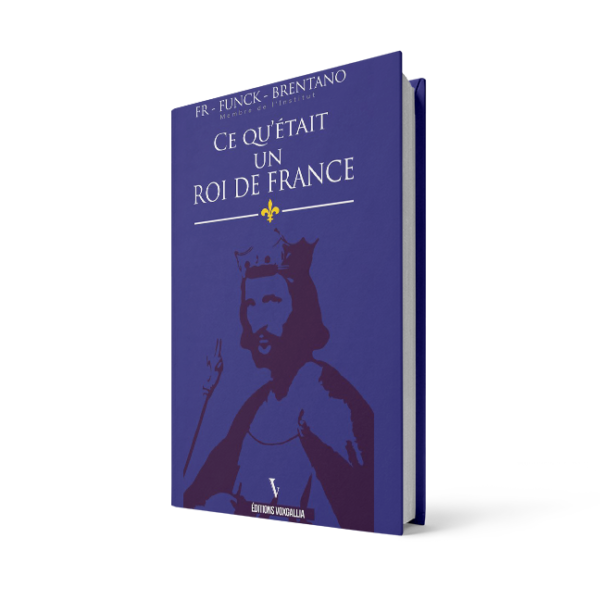
Laisser un commentaire