Votre panier est actuellement vide !
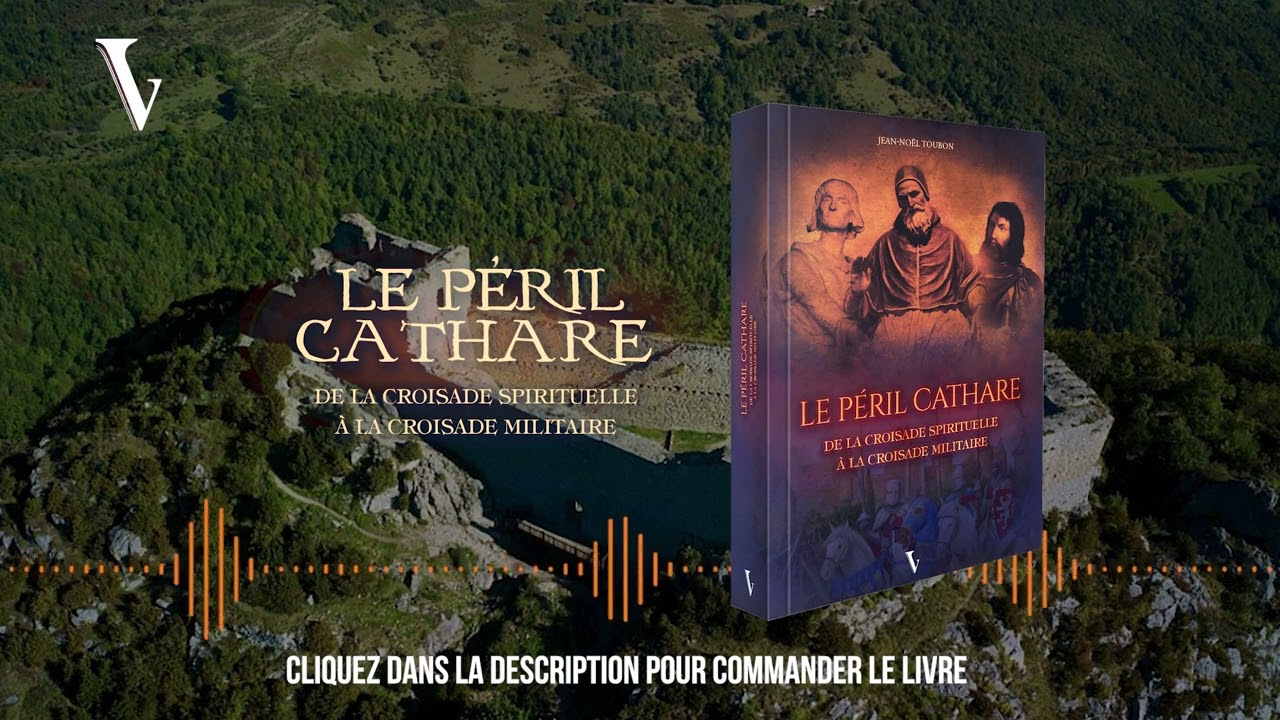
Le siège de Montségur / le péril cathare [Lecture audio]
—
par
Extrait du livre : le péril cathare

Le castrum de Montségur, forteresse perchée en haut d’une montagne et repaire majeur de l’Église cathare, était dans le viseur du pouvoir royal depuis un moment déjà. L’évêque cathare Guilhabert de Castres avait dit vouloir faire de Montségur « le siège et la tête de l’Église cathare ». Pour en finir avec l’hérésie, le concile de Béziers avait décidé de la frapper au sommet. Le 14 mars 1241, à Montargis, Louis IX avait fait jurer à Raymond VII de détruire Montségur dès qu’il pourrait s’en emparer mais ce n’étaient pas les quelques chevaliers qu’il fit mettre au pied du castrum, feignant d’y mettre le siège, qui allaient emporter la chute de Montségur ; sa mauvaise volonté était patente. Le représentant de la Couronne, Hugues d’Arcis, sénéchal de Carcassonne, prit les choses en main ; Montségur devait tomber, entraînant l’hérésie dans sa chute. La mobilisation générale fut proclamée ; les vassaux et arrière-vassaux de la couronne étaient sollicités ; l’évêque d’Albi, Durand de Beaucaire, réussit même à mobiliser une centaine de bons catholiques déterminés à en finir. Un franciscain d’Auvillar avait, de son côté, avec la fougue que seul un prédicateur pouvait avoir, appelé tous les volontaires à se croiser. Tous les villages des environs de
Montségur s’étaient soulevés et, de nouveau, une centaine d’hommes vaillants s’étaient portés volontaires.
Au même moment, pendant que le siège se mettait en place progressivement, la vie à Montségur suivait son cours : Parfaits et simples croyants se côtoyaient. Le quotidien des premiers était spirituel quand celui des seconds était occupé, soit à la vie domestique et au travail, soit à l’organisation militaire du siège à venir. Une centaine de personnes, militaires et civiles, y vivaient sous l’autorité du clan Péreille-Mirepoix. Pendant les années qui ont précédé le siège, les paysans, les marchands et les artisans des environs ravitaillaient régulièrement le castrum de Montségur, alors même que l’Église l’avait formellement interdit. Mais à partir du printemps 1243, « par crainte des Français », comme le disait Arnaud-Roger de Mirepoix, les producteurs n’osaient plus se présenter devant la forteresse. Les habitants de Montségur pouvaient, cependant, compter sur leur importante réserve, accumulée au fil du temps, pour affronter les Français. Face à cet imposant rocher, Hugues d’Arcis ne pouvait le ceindre parfaitement ; il était résolu à ne placer que des postes de garde autour de l’édifice. Deux stratégies s’offraient au sénéchal : soit lancer un assaut – l’opération, au vu du lieu, s’avérait terriblement complexe –, soit mettre le siège, mais comment connaître l’ampleur des réserves du castrum ! Sans réserves de nourriture et d’eau suffisantes, Montségur tomberait avant l’hiver aux mains des croisés ; les coseigneurs du château le savaient bien, mais comme leurs réserves étaient pleines, ils se savaient aptes à tenir jusqu’à l’hiver. L’été se passa sans trop de heurts excepté quelques escarmouches, çà et là, entre les assiégés qui tentaient de quitter discrètement Montségur, et les assiégeants qui en contrôlaient l’accès. Pierre-Roger de Mirepoix, profitant du calme provisoire, envoya un sergent s’enquérir du soutien de Raymond VII. Le comte, qui s’apprêtait à
se rendre à Rome pour s’entretenir avec le pape, demanda aux assiégés, par l’entremise du sergent, de tenir jusqu’à Noël, date à partir de laquelle il pourrait leur prêter mainforte. Hugues d’Arcis voyait l’hiver approcher à grands pas et ne pouvait se résoudre à rester inerte. Alors, avant la Noël, il entreprit un assaut, espérant ainsi se rendre maître de la forteresse. Le chroniqueur Guillaume de Puylaurens le raconte en ces termes :
https://stag04.agence3c.net/produit/le-peril-cathare/
« Des valets armés à la légère furent envoyés avec des hommes qui connaissaient l’endroit ; ils organisèrent de nuit une ascension par des abrupts horribles. Conduits par le Seigneur, ils parvinrent à un ouvrage situé dans un angle de la montagne. Ayant surpris les sentinelles, ils occupèrent ce fortin et passèrent par l’épée ceux qu’ils trouvèrent. Le jour venu, à peu près au niveau des autres, qui occupaient la plus grande position, ils se mirent à les attaquer fortement… Quand ils les eurent enfermés au sommet, un accès plus facile fut aménagé pour le reste de l’armée ».
Le terrain était tellement accidenté et pentu que les affrontements furent finalement peu nombreux ; seules les catapultes, présentes dans les deux camps, expulsaient d’énormes boulets de part et d’autre. Pendant que les combats faisaient rage, Bertrand Marty, l’évêque cathare ayant succédé à Guilhabert de Castres, entreprit de mettre le trésor de leur communauté à l’abri. L’or, l’argent, et une grande quantité de monnaie, fruit du travail des Bons Hommes et des Bonnes Dames du lieu, ainsi que des dons et des legs, furent confiés au diacre Pierre Bonnet et au Parfait Mathieu. En descendant prudemment les sentiers de Montségur, plutôt que de rencontrer les Français qui rôdaient dans les environs, les deux hommes se trouvèrent nez à nez avec des hommes partageant leurs convictions. Un chemin encore plus discret leur fut conseillé et le trésor put être caché dans une grotte fortifiée du comté de Foix. La communauté cathare préférait savoir son argent en sécurité loin des combats, plutôt que de l’imaginer tombé entre les mains des hommes du roi de France. Dans les premiers mois de l’année 1244, les Français, aidés de Gascons, se jetèrent à l’assaut du castrum à l’aide d’échelles, mais un guetteur cathare sonna l’alerte ; l’assaut fut repoussé sans trop de difficulté. Courant février, des hommes et des armes avaient réussi à passer, déjouant ainsi la surveillance des croisés. Le site était tellement escarpé que les passages laissés sans surveillance étaient nombreux. Les sergents rentraient avec la confirmation que le prince toulousain viendrait leur prêter main forte d’ici avril avec les renforts de l’empereur du Saint-Empire romain germanique. Encore fallait-il qu’ils tinssent jusque là. L’information était-elle véridique ou ne servait-elle pas simplement à remonter le moral des troupes ? Les assiégés, submergés par les attaques de boulets détruisant sur leur passage les habitations, devaient être présents sur tous les fronts ; les victimes, celles qui purent voir la mort arriver, reçurent le consolament des mains de Bertrand Marty, l’évêque de la Contre-Église.
Le 2 mars 1244, acculés, Pierre-Roger de Mirepoix et Bertrand Marty demandèrent à parlementer avec le sénéchal du roi de France. Les deux dignitaires cathares exposèrent leurs conditions : une trêve de quinze jours avant de livrer le castrum à l’Église et au roi, ainsi qu’une amnistie générale pour les meurtres d’Avignonet. Ils espéraient bien voir le comte Raymond VII se présenter avec ses hommes au cours des quinze jours de trêve qui leur avaient été accordés ! En vain… Les vainqueurs ajoutèrent d’autres conditions à celles proposées par les vaincus : Pierre-Roger de Mirepoix devra livrer des otages. Les Parfaits et les Parfaites seront livrés à l’Église, et ceux qui refuseront d’abjurer seront livrés aux flammes. Les résidents du castrum, non ouvertement cathares, seraient cependant interrogés par les inquisiteurs. Les hérétiques les plus zélés, ne se faisant pas d’illusion quant à leur sort, se préparaient à la mort ; beaucoup reçurent le consolament des mains de leur évêque. Le 16 mars 1244, les quinze jours de trêve étaient écoulés, Hugues d’Arcy entra en vainqueur dans le castrum au nom du roi de France. L’archevêque Pierre Amiel, au nom de l’Église, s’avança, regroupa les Parfaits et les Parfaites d’un côté et les croyants de l’autre, puis demanda au premier groupe d’abjurer et de se convertir à la foi catholique. Aucun ne se soumit. Deux cent vingt-quatre hérétiques furent alors jetés aux flammes au pied de la montagne. Quant aux simples croyants, ils n’eurent que des peines légères ; et les deux seigneurs, Pierre-Roger de Mirepoix et Raymond de Péreille, ainsi que leurs soldats, purent se retirer sans être inquiétés. La forteresse de Montségur fut remise à Guy II de Lévis, seigneur de Mirepoix, après que celui-ci prêta hommage au roi de France à Paris en juillet. Conformément à la législation canonique, toutes les maisons où avaient vécu et prêché les hérétiques furent rasées, transformant le haut lieu de la résistance cathare en véritable champ de ruines, habité dorénavant par des aigles et des oiseaux.